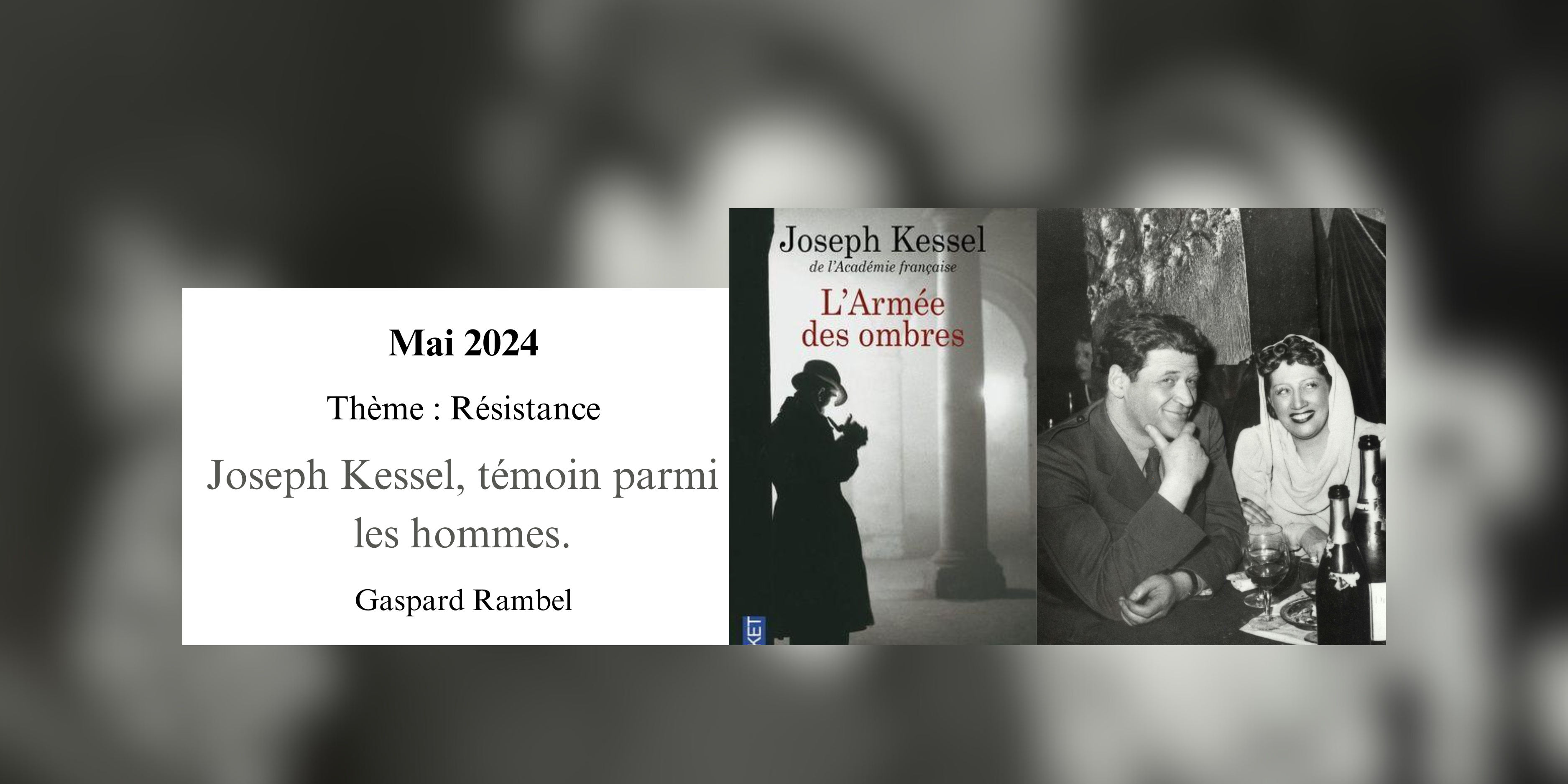S’il y a bien une thématique qui transpire de l’œuvre de Joseph Kessel, comme allégorie d’une encre qui dégage un peu trop de chaleur pour pouvoir tenir sur un simple papier buvard, c’est celle de la résistance. On peut d’ailleurs aisément relier celle-ci aux deux autres que sont la fraternité et la compassion. En effet, elles sont le pendant nécessaire lorsque le simple postier se fait agent de liaison, l’imprimeur éditeur de journaux clandestins et le propriétaire terrien pourvoyeur de cachettes ; pour ceux qui ont placé leur espoir dans la maison commune de l’humanité. « Lui qui n’a même pas le droit d’entrer chez un boulanger, parce qu’il lutte pour toutes les moissons de la France. »[1]
Si l’enfance est un destin, on peut dire que cette maxime se calque parfaitement sur le parcours de l’auteur. En perpétuel mouvement depuis son enfance, il verra le jour en Argentine en 1898 avant de sillonner l’Europe où sa famille finira par s’installer à Paris. De cette éducation cosmopolite, il conserve le goût de l’aventure et le siècle qu’il enjambe semble propice à accueillir une nature de cette trempe.
Les événements historiques donneront la matière nécessaire afin de terminer de sculpter son caractère, tandis que les grandes causes de son époque ficèleront son œuvre. Kessel s’engage à 18 ans dans l’aviation durant la Première Guerre mondiale, voltigeur des cieux avant d’être celui des mots ; il retranscrira son expérience dans son premier roman L’Équipage (1925)[2].
S’ensuit alors une série d’engagements qui accentueront à chaque fois sa soif d’apprendre des autres, de découvrir de nouvelles cultures, à défaut de défendre leur intégrité et souveraineté : au côté des républicains espagnols en 1930 par exemple, ou lorsqu’il sera correspondant de guerre et résistant durant la Seconde Guerre mondiale.
Poursuivant ses pérégrinations autour du globe en tant que grand reporter, il sera élu à l’Académie française en 1963. Dans les dernières années de sa vie, il rédige Les Cavaliers (1967). Dans ce récit, il relate le mode de vie alors inconnu des Afghans. Un documentaire[3], qui à certains égards peut nous rappeler le film Lawrence d’Arabie, accompagnera sa publication.
Dans cet article, néanmoins, c’est à son ouvrage L’Armée des ombres[4] que nous allons nous intéresser. Écrit en 1943 alors qu’il se trouve à Londres, le roman nous délivre une intrigue savamment orchestrée où chaque personnage trouve sa place dans cette arène chaotique qu’est la France occupée. Les différentes péripéties sont d’autant plus prenantes qu’elles sont issues d’histoires vraies. Les personnalités se développent et changent, la frontière traditionnelle entre le bien et le mal s’efface devant la nécessité de l’action, les plus doux se découvrent capables du pire tandis que les plus désabusés semblent se réconcilier avec la société devant cette fraternité inattendue.
« La résistance, elle est tous les hommes français qui ne veulent pas qu’on fasse à la France des yeux morts, des yeux vides. »
Dans cet extrait tiré du premier chapitre du livre, le ton est rapidement donné : l’action, méticuleusement préparée, ne laissera pas le temps aux conversations, slogans, d’empêcher les protagonistes de mener à bien leurs engagements. C’est le personnage de Gerbier qui la prononce. Ingénieur dans le civil, il se lie d’amitié avec Legrain durant sa détention. Ils préparent leur évasion et lorsque celle-ci est sur le point d’aboutir, Legrain refuse de le suivre. Malgré l’insistance de Gerbier qui lui promet des soins et une prise en charge par l’organisation, il lui indique fraternellement que ce qui le motive à s’enfuir, c’est d’être agent de liaison : demeurer alité aux frais de ceux qui ont déjà assez à gérer lui paraissait encore plus insupportable que d’assumer son statut de prisonnier politique, terroriste diront les policiers vichistes et nazis.
Gerbier se vengera dans le chapitre suivant à l’aide du personnage nommé « Le Bison ». Ils retrouveront le traître et il commettra alors sa première exécution. Nous ferons ensuite la découverte de Jean-François, ancien des corps-francs recruté par Félix la Tonsure et dont le récit nous donne, dans les détails, les méthodes clandestines de transmission d’informations, de réception de colis parachutés ou d’astuces pour passer d’une région à une autre sous couverture. Lors d’un détour à Paris, il rejoint son frère Luc, personnage réputé pour son égalité de caractère ainsi que son goût pour la vie spirituelle, ce qui lui a valu le surnom de « Saint-Luc ».
On découvre les planques, l’organisation d’un foyer qui fait office de cachette pour le groupe, à travers le récit des actions de la famille Viellat puis, lors du départ pour Gibraltar afin de rencontrer le patron de l’organisation. Au grand étonnement de Jean-François, il découvre que ce n’est autre que « Saint-Luc », son petit frère.
Les chapitres glissent ensuite seuls grâce à la plume de l’auteur qui nous guide de pages en pages. Nous assistons également à l’évolution des personnages, certains disparaissent, d’autres font l’amer expérience des dommages collatéraux qu’occasionnent ce type d’activités : supprimer un camarade, en l’occurrence Mathilde, lorsque sa piste, découverte et remontée, mènerait alors à plus de secrets préjudiciables pour la résistance.
Tous ces actes, qu’une société en paix empêche de voir naître grâce aux garde-fous que sont les institutions démocratiques, semblent pourtant acceptés par tous en période de troubles, de guerre. La caution à ces agissements étant la conscience d’un intérêt qu’ils estiment supérieur à leur simple individualité, comme lorsqu’un résistant, fervent gaulliste et anti-communiste, dit préférer « (…) une France rouge plutôt qu’une France qui rougit (…) ».
À travers les notes de Gerbier, un rayon de lumière semble nous éclairer et fendre le bouclier du récit en direction de la chaise depuis laquelle l’auteur rédige son roman, comme si Joseph Kessel, résistant lui-même au moment où il écrit ce livre, essayait de nous donner quelques indices sur ce qu’il aurait pu vivre, en prenant soin tout de même de laisser la porte à moitié fermée, le courant d’air des secrets distillés à voix basse prêt à tout moment à se liguer afin de venir la fermer, pour ne pas mettre ses camarades dans l’embarras.
Le célèbre « Chant des Partisans » écrit par l’auteur et son neveu Druon[5] sur un air d’Anna Marly, est évoqué dans le roman. On a pu d’ailleurs l’entendre récemment avant la Panthéonisation de Missak, ainsi que de son épouse Mélinée Manouchian, au Mont-Valérien ; deux autres résistants renommés.
Dans la préface de son livre, Joseph Kessel nous prévient : « Tout ce qu’on va lire ici a été vécu par des gens de France. Mon seul souhait est de ne pas avoir rendu avec trop d’infidélité leur image. »
Pourtant, cette œuvre reste le roman-témoin de la résistance, et si un homme ne peut tout seul retracer le parcours de milliers d’autres, il a pu compter sur ses anciens camarades qui, comme lui, ont aidé à donner suffisamment de pièces afin de pouvoir constituer un puzzle sur lequel on peut se reporter à l’occasion, lorsque l’on souhaite avoir un aperçu fiable de cette époque.
Gaspard Rambel
- L’armée des ombres, page 35, 1943, Editeur : Edmond Charlot. ↑
- https://www.babelio.com/livres/Kessel-LEquipage/5646 ↑
- https://www.lhistoire.fr/classique/%C2%AB-les-cavaliers-%C2%BB-de-joseph-kessel ↑
- https://www.babelio.com/livres/Kessel-LArmee-des-ombres/9872 ↑
- Le chant des Partisans | Chemins de mémoire (cheminsdememoire.gouv.fr) ↑