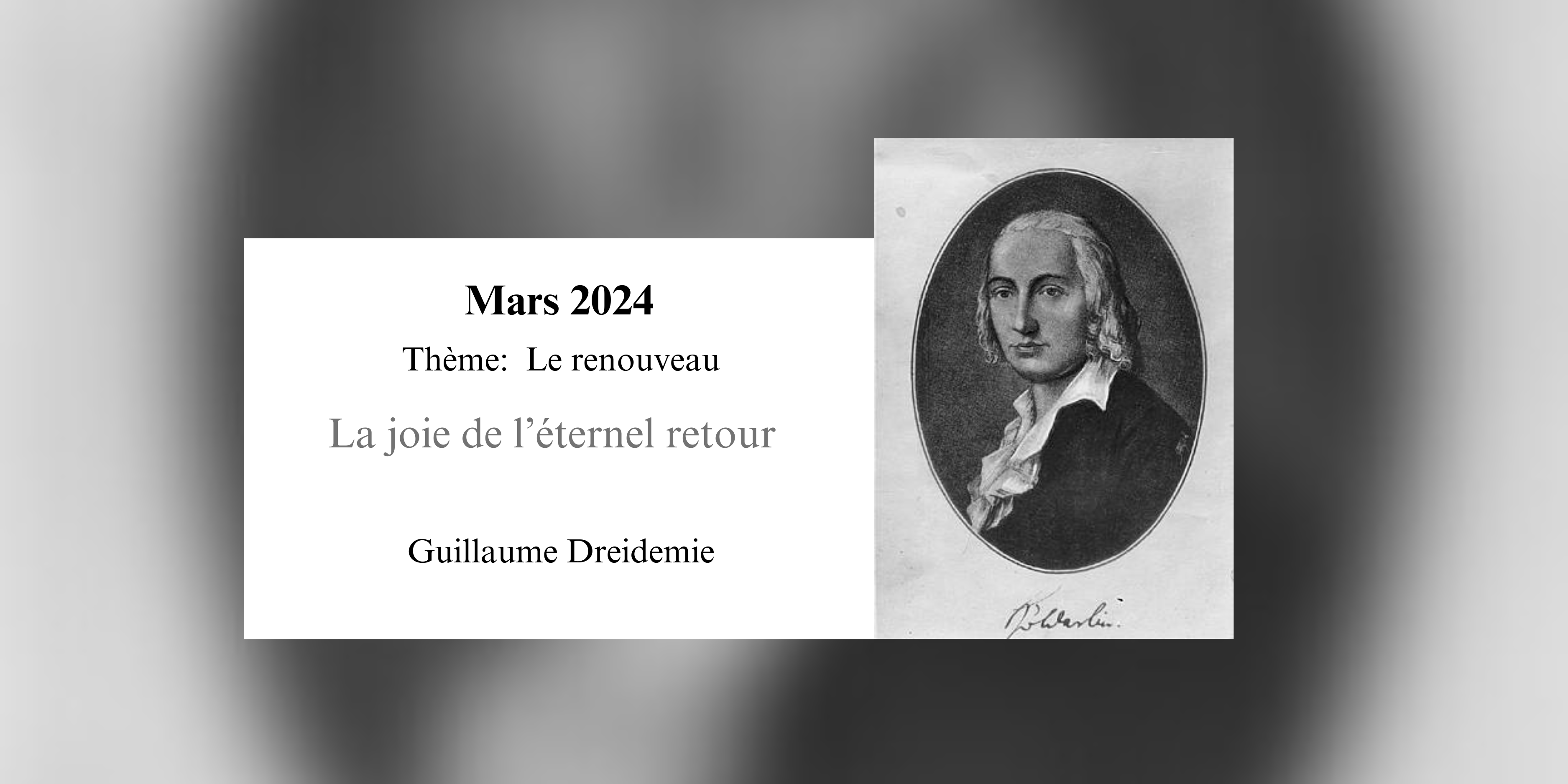Le poète allemand Friedrich Schiller, dans son poème Les Dieux de la Grèce, évoquait un « Âge d’or » et dépeignait l’époque mythique où les dieux gouvernaient le monde « avec les légers liens de la joie » et où « l’amour établissait un doux lien entre les hommes, les dieux et les héros ». Ce « monde riant » a hélas disparu, et le poète déplore que « nulle divinité ne s’offre à [son] regard[1] ». Dans l’Antiquité, les dieux étaient présents aux hommes. À présent, ils se sont retirés.
Schiller n’en reste cependant pas à cette pure lamentation, puisque tous les essais philosophiques qu’il publiera dans les années suivantes, en particulier ses Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme et son essai Sur la poésie naïve et sentimentale, seront consacrés à l’élaboration d’une réflexion visant à « surmonter l’épreuve de la nostalgie » en permettant à l’homme moderne de trouver un sens et une beauté au sein même du monde et de la finitude.
Novalis et Hölderlin ont tous deux lu Les Dieux de la Grèce de Schiller. Ils vont chacun à leur manière interpréter cette histoire de la disparition des dieux. Schiller voyait dans l’apparition du monothéisme la fin de la présence immanente du Dieu dans le monde. La nature, privée de sa divinité, aujourd’hui « semblable au battement mort d’un pendule, suit servilement la loi de la pesanteur[2] », alors qu’autrefois « la plénitude de la vie, tel un flot, traversait toute la création », ce qui fait que l’« on ne sentira jamais ce que l’on sentait alors », car « tout indiquait le regard béni, tout était la trace d’un dieu[3] ».
C’est la même nostalgie des dieux qui anime Hölderlin. Dans son élégie « Pain et vin », Hölderlin écrit qu’« Athènes s’est fanée », que le silence règne dans les « antiques et saints théâtres », et qu’est « morte la danse et sa rituelle allégresse[4] ». Ces paroles font écho à celles du philosophe présocratique Empédocle dans la tragédie qu’Hölderlin lui a consacrée : « Où êtes-vous, mes Dieux ? Hélas, comme un mendiant vous me délaissez[5] ».
Mais dans la nuit moderne règne encore le sacré, car, bien que les dieux aient détourné des hommes leur visage, « nous gardons souvenance des Immortels, qui furent jadis nos hôtes, et qui reviendront au temps propice[6] ». Les poètes du temps de la détresse, semblables aux prêtres de Dionysos qui de pays en pays erraient dans la nuit sacrée, dans cette nuit du monde qu’est la modernité, gardent la mémoire des dieux enfuis.
Le poète moderne doit endurer le retrait des dieux. Mais la conviction de l’éternel retour permet au poète d’endurer ce retrait et lui donne la force de transmettre aux autres hommes son espérance. Habité par l’espoir de l’éternel retour, le poète ne doit pas se jeter dans l’Etna comme Empédocle, mais au contraire poursuivre son chant. La véritable grandeur tragique ne réside pas dans le désir désespéré de mettre fin à ses jours pour échapper à la désagrégation du monde, mais bien plutôt dans l’épreuve du deuil du divin accompagnée de la conviction de son absence présente et de son nécessaire retour en cette vie. Hölderlin a bien vu que l’endurance de la finitude, de la séparation avec le divin, constitue au final une expérience plus profonde du divin que le désir de s’unir immédiatement à lui dans la Mort. Seul l’éternel retour des dieux permettra à ce chaos ambiant de redevenir monde. Un monde qui n’est pas enchanté par les dieux n’est pas un monde à proprement parler, c’est une terre désolée. « Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours », chante Nerval…
De ce point de vue hölderlinien, nous pouvons donc affirmer que le poète a pour tâche de vivifier cette terre désolée de la modernité en chantant avec force d’âme et de cœur le retour des dieux. Le poète est ainsi, littéralement, le réenchantement du monde. Il est le témoin qui permet de passer du cri de la Discorde et de la Barbarie au chant de l’Amitié. Le poète est une figure de la réconciliation. Une figure profondément mondaine, de par sa capacité à transformer une lande déserte, vide de toute spiritualité, en une contrée habitée à nouveau par le souci des dieux. En cette contrée, le poète murmure que les dieux ne sont pas morts, mais seulement endormis.
Face à cette épreuve de la nostalgie, l’objectif est de retrouver la joie. La pensée du retour éternel s’est imposée à Nietzsche en août 1881 lors d’une promenade « à travers bois, le long du lac de Silvaplana[7] ». Dans ses œuvres publiées, il aborde moins l’éternel retour en lui-même que ses conséquences sur l’individu confronté à l’idée de répétition infinie de chaque détail de son existence. Mais, dans certains de ses fragments posthumes, il tente de fonder scientifiquement cette idée de retour éternel.
Dans son œuvre publiée, cette idée se présente comme une interprétation de la réalité qui a valeur de test existentiel : la familiarisation progressive avec cette idée de retour éternel est un véritable voyage initiatique, en ce sens qu’une confrontation avec une telle idée est une véritable épreuve, aux conséquences très concrètes pour l’individu qui s’y confronte. Dans l’objectif de cette confrontation, Nietzsche demande à son lecteur d’imaginer un démon qui lui murmurerait que chaque détail de sa vie doit être à nouveau vécu. Deux réactions majeures sont alors envisageables : l’atterrement mêlé de rage ou une joie immense. Celui qui éprouve une joie pleine et entière à l’idée du retour éternel du moindre détail de son existence a trouvé la force nécessaire pour éprouver l’amor fati, c’est-à-dire un amour sans faille envers la vie présente, passée et à venir.
Nietzsche associe la figure de Dionysos à l’éternel retour, car ce dieu est indiscutablement lié à l’idée de renaissance perpétuelle : dépecé par les Titans, « il renaîtra éternellement et réchappera de la destruction[8] ». L’adjectif « dionysiaque » qualifie un oui extasié au caractère total de la vie, toujours pareil à lui-même au milieu de ce qui change, pareillement puissant, pareillement bienheureux : la grande sympathie panthéiste dans la joie et dans la douleur, qui approuve et sanctifie même les propriétés les plus terribles et les plus problématiques de la vie, en partant d’une éternelle volonté de procréation, de fécondité, d’éternité[9].
Dionysos signifie « l’éternel retour de la vie[10] », « le oui éternel à toutes choses[11] », le fait d’« être soi-même le plaisir éternel du devenir, ce plaisir qui englobe encore le plaisir pris à détruire[12] ». Cette acceptation de la totalité de l’existence est indissociable de la volonté d’intensifier cette existence, grâce à cette ardeur que Nietzsche nomme « volonté de puissance » : le philosophe poète a pour tâche d’intensifier l’existence en brisant, grâce au marteau (de Thor), les valeurs mortifères (issues essentiellement, selon Nietzsche, du platonisme et du christianisme) et en proposant de nouvelles valeurs, vivifiantes, susceptibles d’approfondir la joie.
Hermann Hesse déploie une pensée de l’éternel retour marquée par l’enseignement de Nietzsche, qui affirme que la philosophie n’a pas pour but d’apprendre à mourir, mais bien plutôt d’apprendre à rire. Dans Le Loup des steppes, Hesse écrit ainsi : « Vous avez à apprendre à rire. Pour atteindre l’humour supérieur, cessez d’abord de vous prendre trop au sérieux[13]. » Le voyage initiatique de Siddhartha le mène jusqu’au bord du fleuve incarnant l’éternel retour : « Cette eau coulait, coulait toujours, sans cesser un seul instant d’être là, présente, d’être toujours la même, tout en se renouvelant sans interruption[14] ! » En observant le fleuve en son éternel recommencement, Siddhartha éprouve une joie immense : « La joie et une sereine bienveillance continuaient à éclairer son visage[15]. »
Le fleuve contemplé par Siddhartha n’est pas sans évoquer le « fleuve de vie » qui apparaît au troisième chant du Livre des Processions de Khalil Gibran. Ce dernier a également retenu certaines leçons de Nietzsche, notamment lorsqu’il lui arrive d’envisager les vertus de l’oubli. Son recueil d’aphorismes Le Sable et l’Écume proclame que « l’oubli est une forme de liberté[16] », ce qui correspond en tous points à la thèse nietzschéenne d’après laquelle il est nécessaire d’oublier certains pans de notre passé, notamment les événements porteurs de valeurs mortifères, afin de ne pas devenir ce que Nietzsche appelle des encyclopédies ambulantes, accumulant une vaste érudition inutile pour la vie : seules les connaissances intensifiant l’existence, en un mot, vivifiantes, doivent être préservées.
Guillaume Dreidemie
Université Jean Moulin Lyon III
- Friedrich Schiller, Poésies lyriques, tr. Xavier Marmier, Paris, Hachette, 2013, p. 64. ↑
- Ibid., p. 65. ↑
- Ibid. ↑
- Friedrich Hölderlin, Odes, Élégies, Hymnes, tr. Michel Deguy, André du Bouchet, François Fédier, Philippe Jaccottet, Gustave Roud et Robert Rovini, Paris, Gallimard, 1993, p. 96. ↑
- Hölderlin, Œuvres, tr. Philippe Jaccottet, Paris, Gallimard, 1967, p. 477. ↑
- Hölderlin, Odes, Élégies, Hymnes, tr. Michel Deguy, André du Bouchet, François Fédier, Philippe Jaccottet, Gustave Roud et Robert Rovini, Paris, Gallimard, 1993, p. 97. ↑
- Friedrich Nietzsche, Ecce Homo [1908], III, §1, Paris, Gallimard, coll. « GF », 1999, p. 116. ↑
- Friedrich Nietzsche, Fragments Posthumes, début 1888-début janvier 1889, 14 [89], Paris, Gallimard, coll. « Œuvres philosophiques complètes », n° xiv, 1982, p. 271. ↑
- Ibid., 14 [14], p. 272. ↑
- Id., Le Crépuscule des Idoles [1888], x, § 4, Paris, Gallimard, coll. « GF », 1993, p. 208. ↑
- Id., Ecce Homo, iii, §6, op. cit., p. 127. ↑
- Id., Le Crépuscule des idoles, x, §5, op. cit., p. 210. ↑
- Hermann Hesse, Le Loup des steppes [1927], Paris, Le Livre de poche, 1991, p. 41. ↑
- Hermann Hesse, Siddhartha, p. 116. ↑
- Ibid., p. 142. ↑
- Khalil Gibran, Le Sable et l’Écume, op. cit., p. 23. ↑