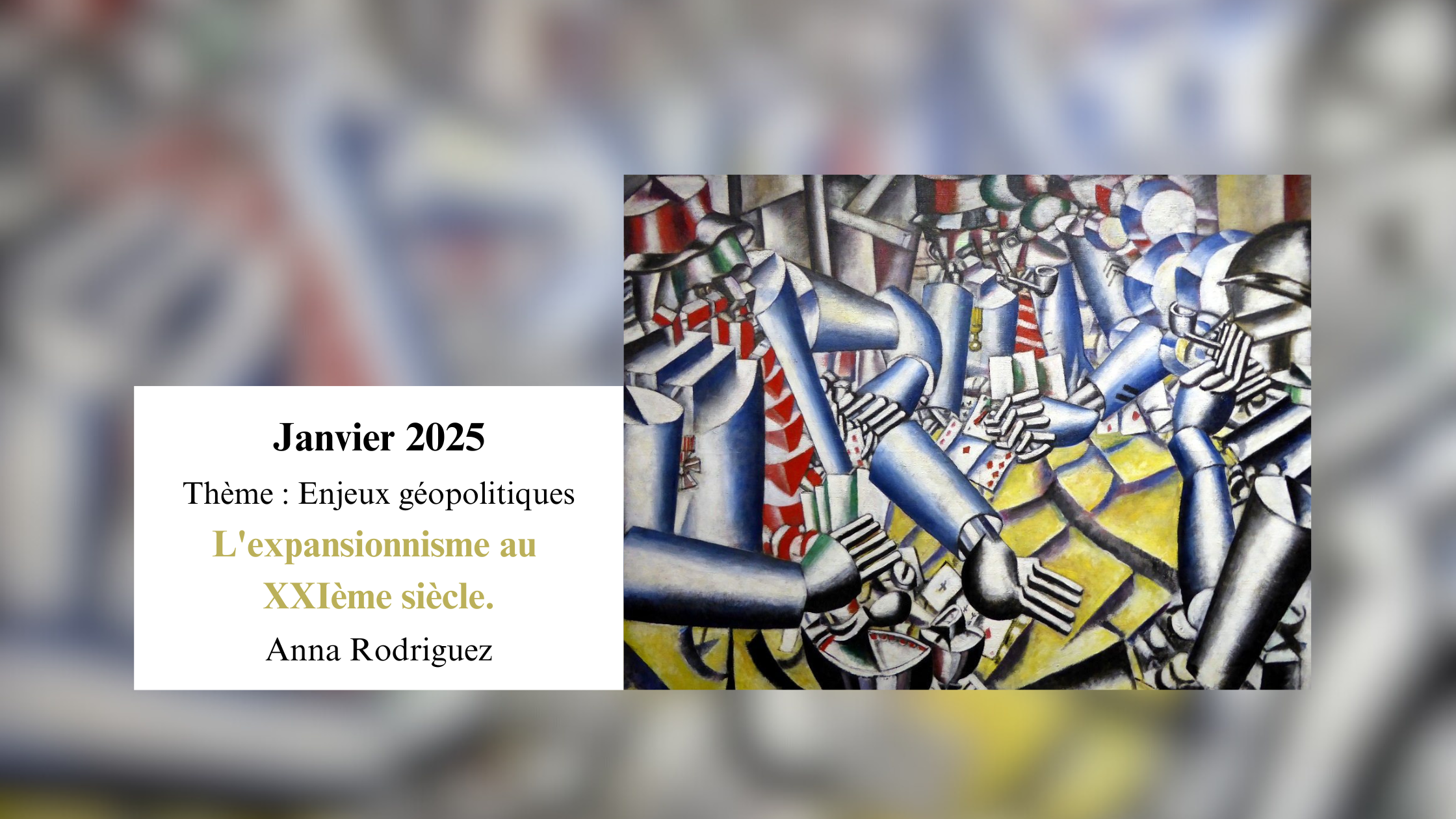Fernand Léger, ‘La Partie de cartes’ (1917), huile sur toile, 129×193, Musée Kröller-Müller, Otterlo, Pays-Bas.
Le 7 janvier 2025, Donald Trump stupéfiait l’ensemble de la communauté internationale en annonçant qu’il appelait de ses vœux une extension du territoire des États-Unis au Groenland, au Canada et au canal de Panama. L’annonce avait de quoi laisser perplexes les observateurs des relations internationales.
Alors que le début du XXIe siècle paraissait marqué par la fin de l’Histoire, répétée à l’envi par tous les adeptes de Francis Fukuyama, il semble, depuis une décennie et, a fortiori depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que l’Histoire ait décidé de s’accélérer. Si les propos du président des États-Unis pourraient rester lettre morte, il n’en demeure pas moins qu’ils sont révélateurs d’un affranchissement du droit international et des doctrines du multilatéralisme jusqu’au cœur même de la puissance qui les avait portés sur la scène internationale, à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
L’expansionnisme par la force
Le basculement idéologique qui s’opère est saisissant. Pour la majorité des citoyens actuels, nous avons été éduqués durant nos programmes scolaires d’Histoire aux deux Guerres mondiales, à leur règlement et à l’établissement de normes et d’institutions internationales, ONU, Union européenne, Organisation mondiale du commerce, entre autres, visant précisément à ce que les relations interétatiques puissent dorénavant être régies par le droit et dans la paix. Non seulement les organisations internationales, au premier rang desquelles l’ONU, affichent de plus en plus leur impuissance face à la volatilité des alliances et à la belligérance des États, mais, en plus, ces derniers semblent se désinhiber progressivement de tous les tabous et règles établies en la matière. La première de ces désinhibitions concerne les frontières.
La frontière : gage d’espoir et de peurs
La frontière, dans son concept et son acception, est sans doute la notion qui cristallise à la fois le plus d’espoirs et le plus de peurs depuis son apparition. Sous l’Antiquité grecque, elle servait à délimiter l’espace de la civilisation de celle des barbares (βάρβαρος en grec), c’est-à-dire ces individus qui ne parlaient pas le grec et qui surtout étaient exclus du rayonnement de ses institutions et de son système de pensée. La définition de Michel Foucher en fait un concept comportant trois dimensions : la dimension réelle, imaginaire et symbolique. Or, c’est bien l’entremêlement de ces trois aspects qui rend la frontière si complexe à appréhender : c’est précisément parce que la dimension réelle de délimitation de la souveraineté ne se juxtapose que rarement avec ses dimensions imaginaires et symboliques que naissent des tensions à son propos.
Néanmoins, avant d’être les sources de tensions que nous connaissons aujourd’hui, qu’il s’agisse de la question de la fermeture à l’altérité (notamment dans le rapport aux migrations qu’entretient l’Union européenne, par exemple, ou dans la construction du mur le long du Mexique aux États-Unis), ou au contraire de la problématique de son abolition ou inexistence, la frontière a été un gage d’espoir durant l’Histoire. L’espoir pour de nombreux peuples à travers le monde de pouvoir se rassembler au sein d’un territoire qui unifierait une communauté sous la houlette d’un État-nation. La frontière comme espoir, mais également comme garantie de protection, puisque la doctrine de l’uti possidetis juris, le fameux principe d’intangibilité, a été posé pour la première fois sur le papier en 1819, au Venezuela, à la suite des indépendances en Amérique latine et sous l’impulsion de Simon Bolivar, lors du Congrès d’Angostura. Ce principe visait ainsi à prémunir les pays naissants des envies de sécession ou d’expansion de la part de ses voisins à travers le continent. Plus tard, lors du printemps des peuples (en 1848), mais aussi de la chute des empires en Europe, la frontière autour d’un État-nation devait encore garantir que les peuples pourraient, à l’intérieur de leur territoire, disposer librement de leur avenir. Il suffit pour s’en rendre compte de se replonger dans les discours et plaidoyers enflammés de Tomáš Masaryk, lorsqu’il militait pour la dissolution de l’empire austro-hongrois et la création d’un Etat indépendant tchèque.
La fluctuation des frontières
Cette dualité entre tensions et espoirs de la frontière subsiste encore aujourd’hui, en 2025. Néanmoins, son caractère intangible, presque déifié, semble progressivement se désacraliser. Partout à travers le monde, les grandes puissances optent pour la politique du fait accompli et ne font que peu de cas du manque de reconnaissance internationale à ce sujet. La Chine s’approprie les archipels Paracels et Spratleys[1], la Russie la Crimée et escompte en faire de même avec tout ou partie de l’Ukraine, sans oublier le conflit au Proche-Orient, ainsi que la pression de la Chine sur Taïwan.
Toutefois, le fait que les États-Unis puissent envisager, eux aussi, d’outrepasser le droit international pour parvenir à leurs fins géopolitiques permet de tirer plusieurs constats : le premier est celui du caractère désormais fluctuant des frontières, le second est la fin d’une dichotomie hypocrite entre le discours et les faits, et le troisième, est celui du retour d’une rhétorique de puissance digne du début du XIXe siècle.
Les frontières semblent ainsi en passe de redevenir fluctuantes et malléables au gré des ambitions étatiques, et ce, quel que soit le régime politique de l’État qui souhaite les reconfigurer. Le critère démocratique semble désormais ne plus être l’apanage du respect de la règle de droit, ce qui tisse d’ailleurs une ouverture sur le tournant potentiellement illibéral de la démocratie américaine.
L’un des seuls points positifs que l’on peut souligner à propos de la rhétorique offensive de Donald Trump est qu’il a le mérite de rompre avec une spécialité américaine de la dualité entre les discours ancrés dans les principes de droit et le multilatéralisme, d’une part, et des faits d’ingérence et d’impérialisme, d’autre part. Noam Chomsky, dans son ouvrage Autopsie des terrorismes, analyse avec justesse la façon dont, depuis des décennies, les États-Unis n’ont eu de cesse d’intervenir dans les affaires d’État de leurs voisins immédiats (en Amérique latine notamment) pour y installer des régimes qu’ils considèrent comme leur étant profitables. Ainsi, le fait de revendiquer haut et fort leur volonté d’étendre leur territoire, par l’achat, la négociation ou la force a, au moins, le mérite d’être clair.
Enfin, ce que dénotent les assertions du futur (re) président des États-Unis, c’est le retour d’un discours de la puissance qui nous ramène aux expansionnismes du XIXe siècle.
L’expansionnisme du XIXe siècle
Lorsque, le 7 janvier 2025, les propos de Donald Trump ont fait l’effet d’une bombe rhétorique dans l’actualité internationale, son discours a semblé sortir de nulle part. Heureusement, les historiens, en bons garants de notre mémoire collective, se sont empressés de rappeler que les appétits des États-Unis sur le Groenland, le Panama et le Canada ne dataient pas d’hier[2]. En ce qui concerne le Canada, le rêve d’unifier l’ensemble du continent nord-américain fait partie intégrante de la naissance de cette nation, puisque Thomas Jefferson, l’un des pères fondateurs, envisageait déjà son annexion au XVIIIe siècle, rêve qui débouchera sur ce que les spécialistes nomment la Seconde Guerre d’Indépendance de 1812 à 1815 sur le territoire canadien et qui opposa les jeunes États-Unis à l’Empire britannique.
Le Groenland, pour sa part, apparut dans la foulée de l’acquisition de l’Alaska à la Russie, soit en 1867, s’inscrivait dans la continuité des tractations commerciales entamées pour la Louisiane, rachetée à la France en 1803. Rappelons également que Donald Trump avait déjà évoqué le possible rachat du pays au Danemark lors de son premier mandat. Le canal de Panama, enfin, était sous la souveraineté américaine jusqu’en 1999 en échange du soutien des États-Unis à l’indépendance du Panama de la Colombie. Ces brefs rappels historiques permettent de restituer le discours de Trump dans le temps long, et mettent également en exergue que la notion de puissance, qui se dessine au niveau mondial dans ce premier quart du XXIe siècle, n’est pas si nouveau que cela, mais trouve ses racines dans un expansionnisme qui remonte au XIXe.
La compétition entre États au XXIe siècle
Certes, les propos de Donald Trump, ainsi que la politique d’annexion et de guerre de Poutine renvoient directement à un sans-gêne impérialiste des puissances du XIXe et rappellent la façon dont la France et la Grande-Bretagne se partageaient le monde. Certes, les institutions internationales, ONU et OMC se font le théâtre d’affrontements protectionnistes entre grandes puissances et, certes, les prises de paroles se font de plus en plus virulentes, en témoignent les agressions verbales d’Elon Musk envers les démocraties européennes. Néanmoins, il faut se garder de céder à la facilité d’un télescopage total entre la situation actuelle et celle qui prévalait au XIXe.
Il ne faut pas céder à la tentation de l’histoire cyclique, car cette lecture masque plusieurs réalités. Tout d’abord, c’est oublier que les acteurs en présence ne sont plus les mêmes : les États-Unis du XIXe siècle n’étaient pas, et, loin s’en faut, une puissance militaire et mondiale de premier plan comme elles le sont aujourd’hui. Désormais, les États-Unis retrouvent un expansionnisme territorial, au moins dans la rhétorique, pour contrer les intérêts géostratégiques de la Chine. Par ailleurs, cet expansionnisme s’intègre dans un cadre de prise de conscience accrue de la finitude des ressources sur une planète où le dérèglement climatique engendre un bouleversement géopolitique majeur. C’est ce que Arnaud Orain, dans son livre Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude, met en lumière. Dans notre monde de raréfaction des ressources naturelles, l’accroissement de la violence, tant physique que verbale, résulterait d’une situation de rivalité insurmontable par les moyens traditionnels du capitalisme et du multilatéralisme.
Comment parvenir à un accord entre acteurs par le biais de l’échange ou de la diplomatie quand les ressources en pétrole, halieutiques, en gaz et en minerais se tarissent de façon inexorable ? Dans ce cadre, la seule possibilité rationnelle serait celle du plus fort : le premier mettant la main dessus remporterait un avantage concurrentiel au moins pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. Certes, ce constat valait déjà au XIXe siècle : ainsi la création de l’Irak par la Grande-Bretagne s’est-elle précisément mise en place dans la volonté de s’accaparer le contrôle de ses ressources en pétrole et pour garantir la prévalence du Royaume-Uni pour l’avenir. En revanche, ce qui a changé entre le XIXe siècle (et le début du XXe) avec le XXIe est que, désormais, notre connaissance des limites de notre planète est acquise. De là, peut-être, cette détermination à s’accaparer des ressources et des territoires, quels qu’en soient les moyens.
L’exception de la puissance douce
L’enracinement historique, et le caractère inédit de la dislocation de la relation transatlantique, est un fait qui se vérifie chaque année. Ce qui est frappant, au regard de l’actualité internationale, c’est l’opposition totale entre le fracas de l’expansionnisme virulent de certaines puissances -déjà amplement nommées dans le cadre de cet article -et l’expansionnisme tranquille de l’Union européenne qui se profile. Sébastien Maillard[3], à ce titre, rappelle l’originalité de la construction européenne qui a permis l’intégration d’un continent entier sans recours à la force.
D’ailleurs, il est curieux de voir comment les projets territoriaux de Donald Trump défrayent les chroniques, tandis que l’adhésion du Monténégro, de l’Albanie ou encore de l’Ukraine est envisagée de manière bien moins émotionnelle, du moins d’un point de vue médiatique. À cet égard, le vocabulaire employé témoigne d’une différence dans l’essence même de l’Union : il n’est pas question d’annexion ou d’expansion, mais d’élargissement. Les États ne se fondent pas dans l’Union, ils adhèrent. L’expansion sans disparition, renoncement à l’identité, l’autodétermination et dans le respect du droit. En un sens, il est regrettable que cette exception ne soit pas davantage louée et mise en avant sur le plan international tant elle relève d’une prouesse de patience et d’un quasi-miracle au regard de l’histoire. Reste à savoir si cette puissance douce et silencieuse pourra se permettre de le rester dans les années à venir et face à la rhétorique musclée tant de ses alliés historiques que de ses adversaires géopolitiques.
Le XXe siècle : une parenthèse ?
2025 marque un quart de siècle dans l’entrée au sein d’un nouveau millénaire et affiche désormais clairement ses ruptures avec l’ordre global établi au siècle précédent. Alors que l’on croyait l’Histoire achevée, la période des empires et des revendications impérialistes révolues, l’actualité nous démontre tous les jours qu’il n’en est rien. La seconde moitié du XXe siècle, porteuse d’espoir afin de réguler l’ordre mondial, semble quelque part n’avoir été qu’une parenthèse éphémère. L’absolue atrocité des conflits de la première moitié avait engendré un désir profond de réguler la compétition des États. Désormais, les USA poursuivent leur retrait du multilatéralisme, les alliances historiques se délitent pour la plupart et la reconfiguration du monde poursuit son cours. De quoi laisser présager une année sous le signe de l’incertitude et à titre de piqûre de rappel, de quoi se souvenir qu’à chaque incartade et tirade enflammée d’un responsable politique, les premiers à en pâtir, ce sont les peuples.
Anna Rodriguez
- https://www.defense.gouv.fr/marine/cols-bleus/cols-bleus-magazine/planete-mer/mer-chine-meridionale-forte-volonte-chinoise-territorialisation ↑
- Voir Ludovic Tournès, Américanisation, une histoire mondiale. ↑
- https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/01/15/les-idees-follement-agitees-par-trump-valorisent-par-contraste-l-originalite-de-l-integration-europeenne-unir-le-continent-sans-la-force_6499045_3232.html ↑