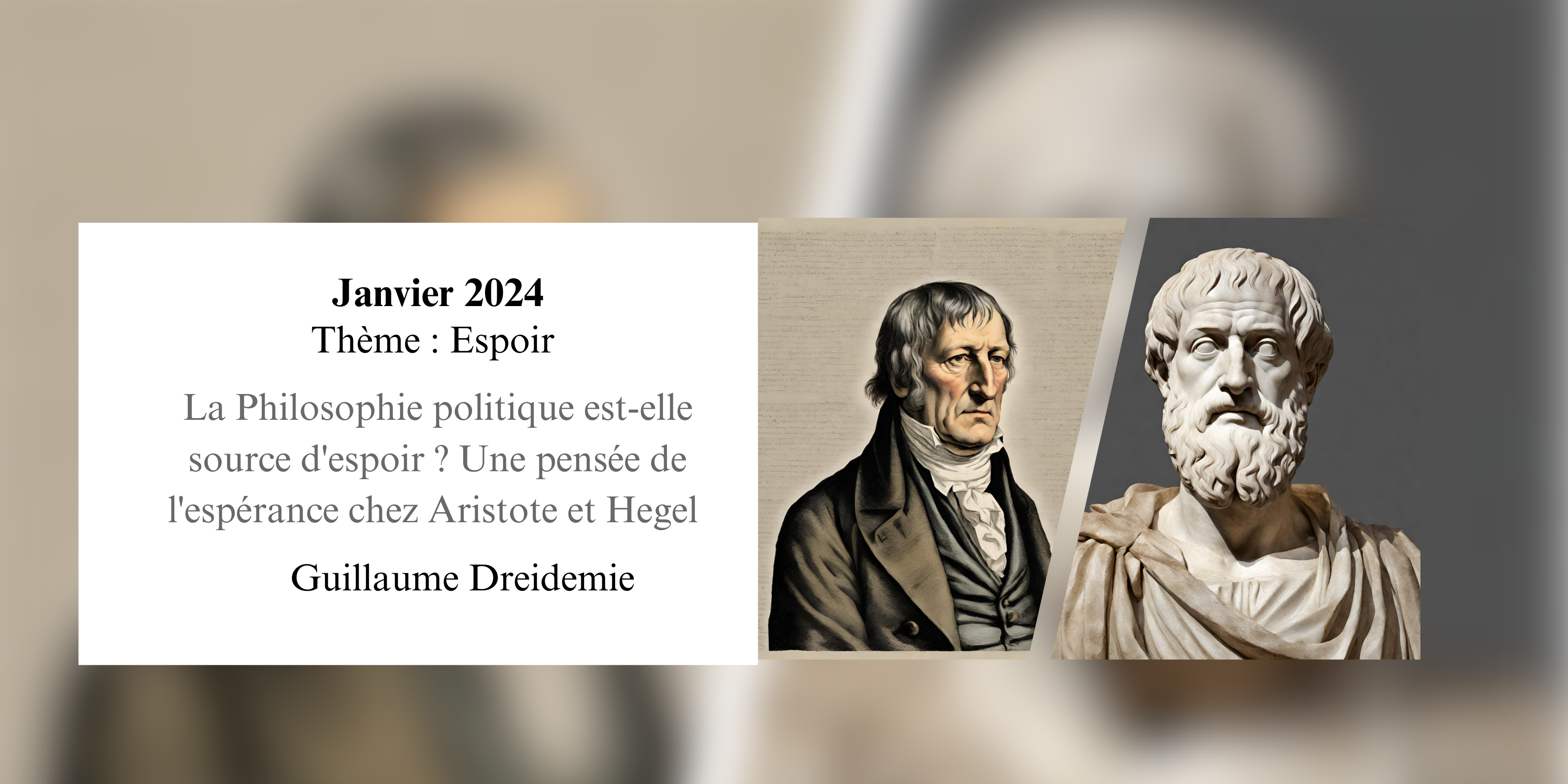« L’extraordinaire intérêt que notre époque porte aux Politiques d’Aristote n’est pas seulement un effet de la révérence due aux grands livres, mais une marque de perspicacité[1] ». La sentence bien connue d’Aristote, « l’homme est par nature un animal politique[2] », nous invite à concevoir que l’individu ne peut trouver son bonheur indépendamment de toute sociabilité. Le sage lui-même n’est pas présenté par le disciple de Platon comme un ermite solitaire, mais bien plutôt comme celui qui jouit de l’amitié.
Dans cette perspective aristotélicienne, la Cité (polis), en tant que communauté politique, constitue pour chaque individu une condition nécessaire à sa propre réalisation, matérielle, mais aussi intellectuelle. L’individu est dès lors le sujet d’un bonheur dont il n’est pas le seul acteur, ce qui signifie qu’il met naturellement son espérance dans les autres individus. Aristote médite alors sur les éléments qui peuvent décevoir cette espérance, d’où ses réflexions relatives à la question du meilleur régime politique. En s’attachant à approfondir les ressources, mais aussi les dangers de chaque constitution politique, que ce soit les démocraties à l’image d’Athènes ou les monarchies à l’image de Sparte, Aristote donne à ses lecteurs la possibilité de préserver une espérance envers le genre humain, capable de tutoyer les dieux pour le meilleur ou pour le pire.
Au cœur du livre des Politiques, l’individu semble dépossédé des conditions de son propre bonheur, mais l’un des objectifs de la réflexion aristotélicienne est précisément d’ouvrir la perspective d’un bonheur commun. La communauté politique n’a pas pour seule fin la simple coexistence des individus, mais bel et bien une action commune. C’est donc sur la nature de cette communauté que doit porter la réflexion : à quelles conditions la communauté politique peut-elle favoriser le bien commun sans sacrifier le bonheur individuel ? Le problème posé par Aristote, et qui demeure toujours d’actualité, est alors le suivant : comment unifier la diversité sociale sans la supprimer ? D’après Aristote, seul le déploiement de la vertu éthique au sein de la Cité peut favoriser le bien de chacun et le bonheur collectif. Notre espérance réside dans la vertu, que nous devons cultiver, par l’éducation et l’enseignement. La philosophie politique devient alors une propédeutique à une philosophie morale, qui nous enseigne que notre espoir réside dans un ensemble plus vaste que nous-mêmes, au sein duquel nous devons comprendre notre place.
Dans ses Leçons sur l’Histoire de la Philosophie, Hegel concentre tout un pan de sa réflexion à l’étude des œuvres aristotéliciennes, dont il célèbre la fascinante singularité : « Aristote a pénétré la masse entière et tous les aspects de l’univers réel, dont il a assujetti au concept la richesse et la dispersion ; la plupart des sciences philosophiques lui sont redevables […]. Il est vaste et spéculatif comme aucun autre[3] ». Hegel souligne la puissance de l’éthique aristotélicienne, qui accorde une importance essentielle à l’espoir contenu dans l’accomplissement d’actes vertueux au sein de l’État.
La philosophie politique hégélienne déploie alors une distinction essentielle, d’inspiration aristotélicienne, entre l’État, qui doit incarner l’intérêt commun, et la société civile, où dominent les intérêts particuliers. Pour Hegel, l’État doit être le dépassement (Aufhebung) de tout point de vue particulier. Un tel dépassement de l’intérêt particulier ne signifie pas sa pure et simple négation, mais cela signifie bien plutôt qu’au sein de ce que Hegel nomme l’État, l’individu peut élargir son horizon et envisager l’épanouissement de sa propre subjectivité à travers son engagement au service d’une Institution, à condition que cette Institution soit éthique. Et elle ne le sera qu’à la condition qu’elle préserve la dignité de ses citoyens.
Hegel établit une distinction nette entre une adhésion immédiate, irréfléchie, d’une part, et la conviction politique réfléchie de découvrir le sens de sa propre existence dans son appartenance à une organisation institutionnelle, d’autre part. La subjectivité singulière ordonnée à une universalité est analysée par Hegel à l’aide de la notion de « politische Gesinnung », que l’on peut traduire par « disposition d’esprit politique » et qui désigne le sentiment de reconnaissance qu’un individu éprouve envers un État dans la mesure où cet individu voit en cet État une institution garantissant ses droits et sa liberté. Une institution en laquelle l’individu a placé son ultime espoir, qu’il appartient aux dirigeants de ne pas décevoir. Ainsi, les droits de l’État à l’égard de ses membres doivent être déterminés par l’adhésion réfléchie que ses membres lui apportent. Un État sera véritablement éthique dans la mesure où il bénéficiera de l’adhésion sincère, réfléchie et explicite de l’ensemble de ses membres. Sans une telle adhésion, l’État n’est plus qu’une institution arbitraire.
Par cette pensée de l’espérance mise entre les mains d’une Cité – pour reprendre le mot d’Aristote – ou d’un État – pour reprendre l’expression à proprement parler « moderne » de Hegel, la philosophie politique place les dirigeants devant leurs responsabilités, mais invite aussi et surtout les citoyens à une réflexion sur leur positionnement au sein de la communauté.
Guillaume DREIDEMIE
Université Jean Moulin Lyon III
[1] PELLEGRIN, Pierre, préface Politiques, Paris, Flammarion, 1993.
[2] ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, livre I, chapitre 5, Paris, Flammarion, 2004.
[3] HEGEL, Leçons sur l’Histoire de la Philosophie, Paris, Vrin, 1972.